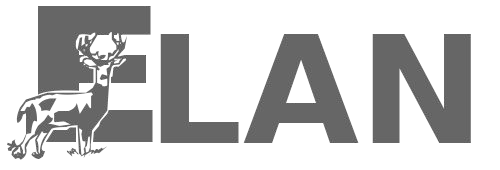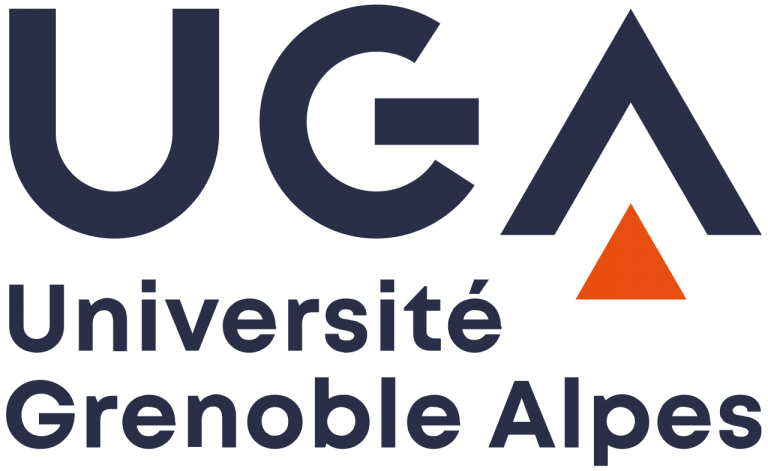Mentions des fonctions ecclésiastiques de Guillaume Cretin
À titre d’exemple et sans avoir la prétention d’être exhaustif, cette annexe recense les titres ecclésiastiques attribués à Guillaume Cretin dans l’édition de ses œuvres ainsi que dans des études, publiées du xviiie au xxie siècles. Il apparaît qu’au fil des ans, après la mort de Guillaume Cretin, les noms de ses titulatures n’ont de cesse de changer, quitte à ce qu’il soit affublé d’une fonction n’ayant jamais existé.
1. Éditions des œuvres de Guillaume Cretin
ca 1509Fauste Andrelin, Epistre de Fauste Andrelin de Forly royal poete lauree, sans lieu d’édition, sans éditeur mentionné, ca. 1509 : « maistre Guill[au]me cretin tresorier du bois de Vince[n]nes » (Page de garde, fol. A1r).
15181Guillaume Cretin, Le Plaidoye de l’amant douloureux et de la dame au cueur changeant, Paris, Guillaume Nyverd, 1518 : « maistre Guillaume Cretin tresorier de la Saincte Chappelle du boys de Vincennes pres Paris » (Page de garde, fol. A1r).
1525Traictez singuliers contenus ou present opuscule, Paris : Galliot du Pré :« feu de bon[n]e mémoire maistre Guillaume Creti[n] nagueres chantre de la saincte chapelle du palais » (page de garde), « feu de bonne memoire maistre Guillaume cretin cha[n]tre de la sai[n]cte chappelle du palais royal a Paris » (« Privilege pour le present livre », fol. A1v), « Faict par maistre Guillaume Cretin, tresorier de la Saincte Chapelle du boys de Vincenne [sic] pres Paris » (Incipit du Plaidoyé de l’Amant (fol. G1r), « feu de bonne memoire maistre Guillaume Cretin nagueres chantre de la Saincte Chapelle du Palais » (colophon, fol. O3v), « monseign[eu]r maistre Guillaume Cretin chantre de la saincte chapelle du palais de Paris (« Chant royal », fol. « Cretin de la saincte trinite » (« Rondeau », fol. H8v).
1526Guillaume Cretin, Debat de deux dames sur le passetemps de la chasse des chiens et oyseaulx, Paris, Jean Longis, 1526 : « faict et co[m]pose par feu venerable et discrete personne maistre Guillaume Cretin En son viva[n]t tresorier de la chappelle du boys de Vincennes chantre et chanoine de la sai[n]cte chappelle Du Palais royal a Paris » (page de titre, fol. A1r), « feu venerable & discrete personne maistre guillaume cretin en son viva[n]t tresorier de la chappelle du boys de Vince[n]nes cha[n]tre & chanoine de la saincte chappelle du palais royal a paris » (Privilège, fol. A1v).
1527Guillaume Cretin, Cha[n]tz royaulx oraisons et aultres petitz traictez faictz et composez par feu de bonne mémoire maistre Guillaume Cretin en son vivant chantre de la saincte chapelle royale a Paris et tresorier du bois de Vincennes, Paris, Galliot du Pre, 1527 : « maistre Guillaume Cretin en son vivant chantre de la saincte chapelle royale a Paris et tresorier du bois de Vincennes » (Page de garde, fol. A1r), « maistre Guillaume Cretin en son viva[n]t chanoine & chantre de la sai[n]cte chapelle du palais royal a Paris » (Privilège, fol. A1v), « maistre Guillaume Cretin en son vivant chantre et chanoine du Palais royal à Paris » (Épître de François Charbonnier, fol. A6v)
1723Anonyme, Les poésies de Guillaume Cretin, Paris, Coustelier, 1723 : « Guillaume Cretin étoit en même temps Chantre de la S[ain]te Chapelle de Paris & Tresorier de celle de Vincennes »2 (p. ii).
1932« Il devait déjà posséder un canonicat à l’église cathédrale d’Évreux, car le 14 mars 1502 (n. st.) il l’échange avec Jean Drouin pour le bénéfice du Fidelaire. Il en prend possession le 21 mars, et le garde jusqu’en novembre 1525. A partir de 1504 il est à Paris, ou bien à Vincennes, et les registres de la Sainte-Chapelle du Palais et de celle de Vincennes nous permettent de suivre sa carrière avec plus de certitude », « il devient chanoine, puis trésorier de Vincennes par des actes datés du 29 et du 30 novembre [1504] : sa réception par les chanoines de Vincennes a lieu le 5 décembre. […] Le 19 septembre 1511 il demande aux chanoines la permission de résigner son office de trésorier. […] Cretin ne donna pas sa démission cependant, et son nom figure sur les registres jusqu’en 1522 », Kathleen Chesney (éd.), Œuvres poétiques de Guillaume Cretin, Paris, Firmin-Didot, 1932, p. xii-xiii. « le premier septembre 1522 Cretin devint chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris. », Ibid., p. xvi. « En 1523 Guillaume de Paris se démet de son office de « chantre », pour prendre poessession d’un bénéfice dans le diocèse d’Auxerre et Cretin lui succède par des lettres datées du 27 juin 1523 ; le jour même il abandonna son bénéfice de trésorier de Vincennes en faveur de son neveu ; qui en prit possession le 3 juillet. », Ibid., p. xvi.
2. Études littéraires
1882Paul Lacroix (éd.), « Notice », Débat entre deux dames sur le passetemps des chiens et des oiseaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1882 : « chantre et trésorier de la chapelle du Bois de Vincennes, qu’on appelait vulgairement la chapelle du Bois » (p. vi), « à la fin de sa vie, chantre de la Sainte-Chapelle de Paris », (p. vi).
1903Henry Guy, « Un “souverain poète français”. Maître Guillaume Cretin », Revue d’Histoire littéraire de la France, 10, 1903 : « trésorier de la chapelle du bois de Vincennes » (p. 553), « chantre de la Sainte-Chapelle de Paris, trésorier de celle de Vincennes » (p. 554).
1904Henry Guy, « La chronique française de maître Guillaume Cretin », Revue des langues romanes, tome 7, 1904 : « prêtre » (p. 388), « chanoine » (note de bas de page 1, p. 391).
2010Jonathan Dumont, « Du souvenir et de l’image : portraits croisés de Louis XI et Louis XII dans les Louenges du roy Louys XII de Claude Seyssel », Bien dire et bien aprandre : revue de médiévistique, 27, 2010 : « trésorier de la chapelle du Bois de Vincennes » et aumônier du roi (p. 101).
2014Béatrice Beys, « L’hommage du livre à François Ier : une image royale multiple », Réforme, Humanisme, Renaissance, 79, 2014 : « Guillaume Cretin aumônier du roi et trésorier de la Sainte-Chapelle » (p. 106).
2022Ellen Delvallée, « La Renaissance épistolographique dans l’œuvre de Guillaume Cretin », Arts et savoirs, volume spécial consacrée au thème Lire les savoirs dans les recueils épistolaires d’Ancien Régime (xvie-xviie siècle), 2022 : « chanoine » de la Sainte-Chapelle de Vincennes (p. 2, 4, 5, 6, 8-10).
3. Études d’histoire
1645Guillaume Dupeyrat, L’histoire ecclésiastique de la cour ; ou les antiquitez et recherches de la chapelle, et oratoire du roy de France depuis Clovis I iusques à nostre temps, volume 1, Paris, Sara, 1645 : « Aumosnier du Roy » (p. 454).
1788 Guillaume Poncet de la Grave, Mémoires interessans pour servir a l’histoire de France, tome 1er, Paris : Nyons, 1788 : « en même temps Chantre de la Sainte-Chapelle de Paris & Trésorier de celle de Vincennes » (p. 227).
1791Aubin-Louis Millin, Antiquités nationales ou recueil de monumens, tome deuxième, Paris : Drouhin, 1791 : « il avoit été chantre de la Sainte-Chapelle de Paris, aumônier du roi, enfin trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes » (p. 53).
1744Gallia christiana, tome 7 : archevêché de Paris, Paris : 1744, « II. Guillemus I. Cretin canto antiquus Sacrae capellae Parisiensis, factus postmodum thesaurarius Vincennensis, que potiebatur dignitate an. 1520. sepulturam accepit cum tumba in ecclesia sua. » (p. 251).
1751Gallia christiana, tome 9 : province de Reims, Paris : 1751 : Guillaume Cretin est considéré comme le vingt-troisième doyen de Châlons-en-Champagne (decani catalaunenses) depuis le 10 juin 1520 (colonne 904).
4. Études en musicologie
1864Ernest Thoinan, Les origines de la chapelle-musique des souverains de France, Paris, A. Claudin, 1864 : « aumônier ordinaire de Louis XII » (p. 74).
1864Ernest Thoinan, Déploration de Guillaume Cretin sur le trépas de Jean Okeghem, Paris, A. Claudin, 1864 : « chanoine, -trésorier,- chantre et poëte » (p. 2), « trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes, puis chantre de la Sainte-Chapelle de Paris et aumônier ordinaire du roi » (p. 4).
2015Charles-Yvan Élissèche, La vie musicale à la Sainte-Chapelle de Paris aux xvie et xviie siècles : étude du personnel musical, thèse de musique et musicologie, soutenue à l’Université de Tours-CESR, en juillet 2015 : « Guillaume Cretin occupe la trésorerie de la Sainte-Chapelle de Vincennes en plus d’une prébende de la Sainte-Chapelle de Paris », p. 378.
2015Jacques Szpirglas, Prosopographie des musiciens des Saintes-Chapelles de Paris (1248-ca. 1640) et de Bourges (1405-ca. 1640), thèse de musique et musicologie, soutenue à l’Université de Tours-CESR, en novembre 2015 : « Grand Chantre » (p. 77 et p. 255)3.
2022Charles-Yvan Élissèche, Le Personnel musical de la Sainte-Chapelle de Paris, xvie et xviie siècles, Paris, Classiques Garnier, 2022 : « Guillaume Cretin occupe la trésorerie de la Sainte-Chapelle de Vincennes en plus d’une prébende de la Sainte-Chapelle de Paris » (p. 364).
Note n°1
Cette datation est proposée par Marion Pouspin, Publier la nouvelle. Les pièces gothiques, histoire d’un nouveau média (xve- xvie siècles). Annexe. Répertoire des pièces gothiques imprimées aux xveet xviesiècles, Paris, Publications de la Sorbonne, p. 48.
Note n°2
L’italique est celui de l’impression initiale.
Note n°3
Ce qualificatif de « grand chantre » ne se réfère à aucune réalité historique ou législative en usage à la Sainte-Chapelle de Paris.
Note n°4
Note n°5
Note n°6
Note n°7
L’inventaire actuellement en usage est un répertoire numérique dactylographié par Patricia Mochkovitch, Série LL [.] Monuments ecclésiastiques [.] Registres, Paris, Centre historique des Archives nationales, 2001, 72 p. Il s’agit de la version dactylographiée par Patricia Mochkovitch de l’inventaire manuscrit établi à la fin du xixe siècle, mis à la disposition du public dans l’attente d’une révision complète. Afin de faciliter la consultation des notes de bas de pages, tous les articles actuellement conservés aux Archives nationales de France (CARAN), signalés sous les cotes L et LL sont uniquement signalés par leur cote.
Note n°8
Une présentation plus détaillée des mémoriaux LL623-LL625 est mentionnée dans Charles-Yvan Élissèche, « Les sources administratives », Le personnel musical de la Sainte-Chapelle de Paris, op. cit., p. 22-24.
Note n°9
Patricia Mochkovitch, Inventaire de la Série LL.op. cit.
Note n°10
LL 620, fol. 1r-33v.
Note n°11
LL 620, 34r-58r.
Note n°12
LL 620, 58v-153v. Ces quittances de paiements ne sont pas toutes datées, mais sont produites entre 1474 et 1480.
Note n°13
C’est le cas, par exemple, aux folios 7-8 : des délibérations des années 1476 et 1477 sont entremêlées, sans logique administrative.
Note n°14
LL621, fol. 1r-79v.
Note n°15
LL 621, fol. 80r-136r.
Note n°16
LL621, fol. 136v-142r.
Note n°17
LL622, fol. 3r-74r.
Note n°18
LL622, fol. 74v-83v.
Note n°19
LL622, fol. 84r-130r.
Note n°20
LL622, fol. 130v-132r.
Note n°21
LL622, fol. 132v-163r.
Note n°22
Charles-Yvan Élissèche, Le personnel musical de la Sainte-Chapelle de Paris, op. cit., p. 22-24.
Note n°23
Note n°24
Note n°25
Note n°26
Note n°27
Note n°28
Note n°29
Note n°30
Note n°31
Note n°32
Note n°33
Note n°34
Note n°35
Note n°36
Note n°37
Note n°38
Note n°39
Note n°40
Note n°41
Note n°42
Note n°43
Note n°44
Note n°45
Note n°46
Note n°47
Note n°48
Note n°49
Note n°50
Note n°51
Note n°52
Note n°53
LL 640.
Note n°54
LL 641.
Note n°55
Sont tenus en français les délibérations des 3 novembre 1514 (LL640, fol. 62v), 13 novembre 1517 (LL640, fol. 72r), 23 mai 1521, dont seule la date est en français (LL640, fol. 78v), 7 mars 1521 (LL640, fol. 80r) et 8 mai 1523 (LL640, fol. 81r).
Note n°56
Édouard Gautier, Essai sur l’Histoire du Chapitre de Vincennes de 1379 à 1790, Paris, Position de thèse de l’École des Chartes, 1888, fol. 2v.
Note n°57
Une étude codicologique serait nécessaire pour mieux utiliser cette source et en comprendre la constitution. Elle reposerait principalement sur l’étude des filigranes, mais cette tâche sort largement du cadre de cette publication.
Note n°58
Dans la marge de gauche, la liste des ecclésiastiques présents au Chapitre est mentionnée. Ils sont fréquemment désignés comme les capitulantes, (cette mention apparaît pour la première fois le 23 avril 1488, LL 640 fol. 7r). Leurs patronymes sont parfois regroupés en deux ensembles : celui des chanoines (dans lesquels sont compris les trésorier et Chantre) et celui des vicaires. Les chanoines et les vicaires sont signalés par leurs patronymes alors que le trésorier et le Chantre ne sont mentionnés que par leurs seules fonctions ecclésiastiques.
Note n°59
C’est notamment le cas du folio [88], déchiré et en mauvais état, dont l’actuel recto est vraisemblablement le verso (et vice-versa), puisque la décision du 10 juin 1524 (LL 640, fol. [88]v) fait suite, dans l’actuelle relire, à celle du 17 juin de la même année (LL 640, fol. [88]r)
Note n°60
LL 641, fol. [1]r.
Note n°61
LL 641, fol. 92r.
Note n°62
Nous n’avons pas pu avoir accès aux annexes de cette thèse.
Note n°63
LL 641, fol. 49v-50r.
Note n°64
Sous réserve de vérification des patronymes, c’est le cas, du décès du chanoine Philippe Labbé, le 25 juin 1540 (LL6411, fol. 49v) ; de la réception de Jehan Prevost comme vicaire et de celle de Jehan Fercocy comme chanoine, le 4 février 1540 (LL6411, fol. 50r) ; de la déception de Pierre Bisson comme chanoine, le 21 février 1540, de celle de Jehan Adet comme chanoine, le 9 mars suivant, de celle de Guillaume Bouigut comme vicaire, le 20 mars et de celle de Symon Leclerc, le 8 avril (LL6411, fol. 51r) ; de la réception de Jehan Dantan comme clerc, le 26 mai 1542 (LL641, fol. 56r) ; de la réception de Nicolas Brasseur à l’office de clerc, le 28 décembre 1543 (LL641, fol. 58v) ; de la mention du départ de Jehan Prevost et de la réception, aux fonctions de vicaire pour le remplacer, de Robert Le Sueur, le 23 janvier 1543 (LL641, fol. 59r) ; de la réception de Simon Le Clerc comme vicaire et de celle Jehan Bourrieux comme clerc, le 20 janvier 1544 (LL641, fol. 61v) ; du décès du Chantre, Étienne Duborchet, le 18 août 1547 (LL641, fol. 69r) ; de la réception du trésorier, Guillaume Maulbuisson le 7 septembre 1547, et de celle de Jérôme Joseph (sans précision de ses fonctions) (LL641, fol. 69v-70r) ; de la réception du chanoine Claude Germain, du vicaire Nicolas Lebrasseur et du clerc Pierre Dubochet, le 3 septembre 1547 (LL641, fol. 70r) ; de la fin du vicariat de Jehan Borienne le 16 septembre 1548 (le millésime n’est pas précisé, mais une mention postérieure laisse présager qu’il s’agit de l’année 1548), de la réception de Guillaume Montbrisson aux fonctions de trésorier le 17 septembre suivant, et de celle de Philippe Ferocq comme Chantre le 18 septembre suivant (LL641, fol. 70v) ; de la réception de Gaudefroi Engren comme clerc, le 28 octobre 1547, et de la fin de sa période de probation le 2 octobre suivant (LL641, fol. 71r) ; du décès du Chantre Philippe Ferocq le 27 juillet 1549, et de la réception de son successeur, Jehan Moriceau le 7 août suivant (LL641, fol. 72r) ; de la réception de Toussaint Musnier comme chanoine, de celle de Godefroi Engren comme vicaire, et de celle de Mathieu Guyot comme clerc, le 9 août 1549, alors que le 18 octobre suivant, un dénomme Borrisner est rayé de la table (LL641, fol. 72v) ; de la réception de Simon Leclec comme chanoine, et de celle de Pierre Bochet comme vicaire, le 1er janvier 1549, mais encore de celle de François Vitry le 7 février suivant (LL641, fol. 73r).
Note n°65
Un cas particulier, mettant en avant ce qui pourrait être jugé comme un manque de systématisme dans la tenue du registre, concerne le décès du trésorier, en 1544. En effet, une délibération du 4 juin relate, en français, que la trésorerie vacante (LL641, fol. 59v). La mention du décès de ce dignitaire est rapportée en latin, par une autre main, dans la partie inférieure du folio suivant, le 7 février 1544 (LL641, fol. 60r). La trésorerie était donc vacante en raison du décès de son titulaire, et pas pour des questions d’abandon de la fonction. Or, cette mention du 7 février 1544 relatant la mort du trésorier, est relatée après une délibération du 10 octobre 1544 (LL641, fol. 60r), 4 mois avant. Tout se présente comme si les mentions en latin, relatives aux fonctionnaires ecclésiastiques du Chapitre, prestant dans la Sainte-Chapelle, avaient été rajoutées a posteriori, afin de laisser un précédent écrit, sans plus de détail.
Note n°66
LL641, fol. 70r. Un dénommé Mathieu Guyot est reçu comme clerc le 9 août 1549 (LL641, fol. 72v). Peut-être s’agit-il de la même personne ?
Note n°67
LL641, fol. 74r. Il est à noter que certaines délibérations concernent davantage la vie de cour que la vie canoniale. C’est, par exemple, le cas du 7 septembre 1544 où il est rapporté que les enfants royaux sont cachés à Vincennes en raison de l’invasion de Charles Quint (LL641, fol. 61r). Le 9 octobre 1560, il est rapporté seulement la venue de Marguerite de Valois et du duc d’Anjou (LL641, fol. 90v), alors que le récit de délibération suivant ne concerne que le départ de Marguerite de Valois et des dames de la reine pour Orléans, le 28 octobre suivant (LL641, fol. 90v). Certaines mentions relatives à la vie monarchique ne relatent pas la participation des membres du Chapitre aux festivités, ni même la célébration d’un office en action de grâces. C’est le cas, par exemple, pour le mariage d’Isabelle de France à la cathédrale Notre-Dame à Paris (LL641, fol. 88r), ou encore le sacre de Charles IX à Reims, relaté le 15 mai 1561 (LL641, fol. 92r). Ces mentions sont surprenantes dans la mesure où le Chapitre fait état d’une participation spirituelle active à la préservation de la santé du roi Henri II, et au salut de son âme. En effet, la première mention de sa blessure est seulement relatée dans une délibération du 30 juin 1559 (LL641, fol. 88r). Par la suite, il est relaté la célébration d’une procession « aux bons honne[ur]s po[u]r la prosperite du roy » le 9 juillet 1559 (LL641, fol. 88r). Enfin, son trépas est mentionné au 10 juillet 1559, « po[u]r lequel le Jo[u]r EnSuyvant fut celebre ceans ung obit sol[emne]l » (LL641, fol. 88r). La célébration de l’obit solennel est confirmée par le récit d’une délibération datée du lendemain, le 11 juillet 1559 (LL641, fol. 88r). Certaines délibérations concernent plutôt la gestion du patrimoine. En effet, il est fait état d’un don d’habits liturgiques par Henri II, le 12 avril 1550 (LL641, fol. 72v), ainsi qu’un don de la duchesse de Valentinois (principalement des vases sacrés, et objets liturgiques) le 20 novembre 1551 (LL641, fol. 73v). EN outre, le 24 août 1552, est établi un inventaire des reliquaires et des reliques envoyées par Henri II et la duchesse de Valentinois à la Sainte-Chapelle (LL641, fol. 74rv).
Note n°68
C’est notamment le cas pour le récit des délibérations capitulaires établies entre le 8 mai 1555 et le 26 juin 1555 (LL641, fol. 76v-77r).
Note n°69
LL641, fol. 77v.
Note n°70
« comme on a acoustume faire aux obitz defeu maistre Jehan crete et defeu maistre estienne deparis aussi jadiz tresorier et chanoine delad[icte] chappelle du boys de vinciennes », L 625/30. Voir la transcription de cet acte sur la page « L’obit de Guillaume Cretin » (point 3)
Note n°71
LL640, fol. 46r. Avant la nomination de Guillaume Cretin aux fonctions de trésorier de la Sainte-Chapelle, la trésorerie était déclarée officiellement vacante lors du Chapitre général du 26 juin 1504 (LL 640, fol. 43[bis]r). Dans une délibération du 26 juin 1531, soit 27 ans après le départ d’Estienne de Paris, le secrétaire relate les conditions de réception de l’obit de l’ancien trésorier (LL641, fol. [18]v-19r). Cet obit est à nouveau mentionné le 12 novembre 1533 (LL641, fol. 28v) et le 8 avril 1533, date de la réception de l’épitaphe (LL641, fol. 30r). Le 25 mars 1555 il est fait état de certains modifications cérémonielles (LL641, fol. 79v). Il y est aussi mentionné l’obit d’un dénommé Jehan Creti. L’orthographe du patronyme est proche de celle de Guillaume Cretin. Il est à noter que les dates de l’obit de Jehan Creti et de celui de Guillaume Cretin ne sont pas les mêmes, sans que cela exclue un possible déplacement de l’obit de Guillaume Cretin. À défaut d’une étude exhaustive sur le personnel ecclésiastique de la Sainte-Chapelle de Vincennes, il est difficile de savoir si la modification des obits solennels du 25 mars 1555 concerne aussi celui de Guillaume Cretin.
Note n°72
« Co[m]me il est plus aplain co[n]tenu au Regi[str]e Dud[ict] chapp[it]re en Laco[n]clusion faicte aud[ict] chapp[it]re Lan mil cinq cens trente six le vingt six[ies]me Jo[u]r de Juing », L 625/30. Voir la transcription de cet acte sur la page « L’obit de Guillaume Cretin » (point 3).
Note n°73
En effet, la délibération du 25 juin 1536 ne fait pas état de l’enregistrement de cet obit (LL 6540, fol. 37r), ni la délibération suivante, datée du 23 mai 1537 (LL 6540, fol. 37v)
Note n°74
Note n°75
Note n°76
Note n°77
Note n°78
Note n°79
Note n°80
Note n°81
Note n°82
Note n°83
Note n°84
Note n°85
Bruno Galland et Patricia Mochkovitch, Série L [.] Monuments ecclésiastiques [.] Titre V [.] Collégiales et paroisses du diocèse de Paris Saintes-Chapelles […] Inventaire sommaire des cartons L 618 à L 628, Paris : Centre historique des Archives nationales, 2001-2002, 114 p.
Note n°86
Le patronyme est parfois orthographié « de Coste ».
Note n°87
Il s’agit de l’étude portant actuellement, à Paris, Archives Nationales de France (CARAN), Minutier Central, étude XIX. C’est aussi l’étude dans laquelle a presté Pierre Ier Pichon, dans laquelle Guillaume Cretin signe un bail le 14 juin 1497 (Paris, Archives Nationales de France (CARAN), Minutier Central, MC/ET/XIX/12). Ce document est évoqué dans le sous-sous-chapitre « 4.2.1. Curé de Campeaux (1497) ».
Note n°88
Le soulignement est celui du texte original.
Note n°89
La transcription de cet article ainsi que la transcription du suivant ont pu être finalisées grâce à précieuse amitié et à la compétence de Madame Laetizia Puccio (assistante aux Archives de l’État, Namur). Qu’elle se voie chaleureusement remerciée pour son soutien et ses précieuses remarques.
Note n°90
« Jadis » est mentionné au-dessus de « Cretin ».
Note n°91
Guillaume Poncet de la Grave, Mémoires interessans pour servir à l’histoire de France, tome 1er, Paris, Nyons, 1788, p. 232.
Note n°92
Aubin-Louis Millin, Antiquités nationales ou recueil de monumens, Paris, Drouhin, vol. 2, 1791, p. 51-52.
Note n°93
Sur la même gravure, la pierre tombale représentée et signalée par le chiffre 1 est celle d’un chevalier (Aubin-Louis Millin, Antiquités nationales ou recueil de monumens, op. cit., p. 49) et celle signalée par le chiffre 2 est celle de Marguerite de La Touche (ibid.).