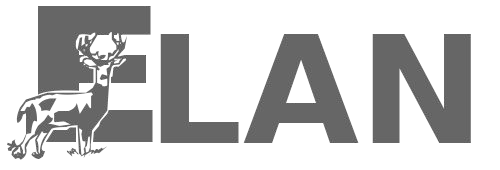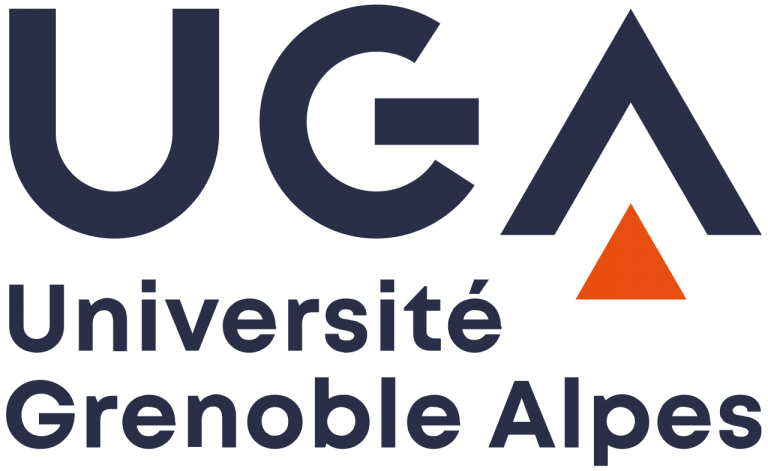Principes éditoriaux
Choix du manuscrit de base
Le texte servant de base à notre édition est celui qui est contenu dans la série de manuscrits conservés dans le fonds français de la Bibliothèque nationale de France sous les cotes 2817 à 2822. Il s’agit des manuscrits offerts à François Ier par Guillaume Cretin. Cette série se rapproche en effet le plus du projet initial de Cretin, explicité dans un prologue général en prose. De plus, il apparaît fréquemment que les manuscrits de cette série présentent des leçons uniques suggérant que Cretin est revenu sur son texte à l'occasion de la commande de cette copie luxueuse (par exemple, dans le livre I, aux vers 411-412 et 2852-2853). Nous ne corrigeons ce manuscrit de base que lorsque l'erreur est évidente et aisément rectifiable (par exemple, "droctine" est corrigé en "doctrine").
Voir la page concernant les manuscrits pour des remaques sur les différents témoins.
Transcriptions
Le texte est disponible en version diplomatique et semi-modernisée.
Pour la version diplomatique, le choix a été fait de transcrire une version la plus fidèle possible du texte du manuscrit de base, en respectant graphie, orthographe, abréviations, ponctuation (notamment les nombreuses virgulae, souvent à la césure) et mise en page.
Pour la version semi-modernisée, nous ne modifions pas l’orthographe mais nous modernisons certains éléments du texte afin d’en faciliter la lecture. Nos principes, rappelés ci-dessous, sont pour la plupart conformes aux conseils de l’École des Chartes (Pascale Bourgain et Françoise Vielliard, Conseils pour l'édition des textes médiévaux, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques / Ecole Nationale des Chartes, 2001) :
- dissimilation des i/j et u/v
- régularisation de la graphie des s et r
- développement des abréviations (y compris esperluettes et voyelles avec tilde)
- ajout des apostrophes et cédilles
- usage moderne des majuscules (le roi, notre Seigneur)
- séparation des mots agglutinés et agglutination des mots séparés, mais sans ajouter de trait d’union et sans restituer les élisions (pource, ledit, puysque…)
- ajout de l’accent aigu pour tous les noms, adjectifs et participes passés en « -é », « -és », mais pas les terminaisons en « -ez », « -ee » ou « -ees » qui se prononcent forcément [é].
- ajout de l’accent aigu pour les mots dont la dernière syllabe se prononce (trés, aprés…)
- ajout des accents graves pour dissimiler les homophones (à, là, où)
- emploi des trémas pour indiquer les diérèses et hiatus dans les vers (crestïens)
- emploi des ligatures (œ) si elles ne figurent pas dans le manuscrit de base
- introduction de guillemets pour les propos rapportés
- introduction des italiques (pour les titres des livres mentionnés et langues étrangères)
- ponctuation modernisée (en particulier, les barres obliques sont supprimées ou remplacées par des virgules)
- usage moderne des paragraphes (remplacement des pieds-de-mouche par des retours à la ligne avec alinéa, création d’autres paragraphes selon le sens)
La ponctuation de la version semi-modernisée est entièrement nôtre et elle se veut la plus exhaustive possible pour faciliter la compréhension du texte. Nos principes sont à nouveau conformes aux conseils de l’École des Chartes :
- respect des usages du français moderne, sauf exceptions listées ci-dessous
- une virgule ou un point peuvent apparaître en fin de proposition y compris si la suivante commence par une conjonction de coordination
Précisions sur les virgules et les points-virgules :
- pas de virgule entre sujet - verbe et verbe - complément d’objet
- on se conforme, pour les propositions subordonnées, aux usages du français moderne (pas de ponctuation entre une proposition principale et une consécutive par exemple « tant… que… ») sauf si ces propositions font plus de 1 vers
- on isole autant que possible des adverbes ou locutions adverbiales entre virgules pour faire respirer les phrases
- quand la phrase commence par un adverbe ou une locution adverbiale, on ajoute une virgule (surtout si elle tombe après la 4e syllabe, pour faire ressortir le rythme du décasyllabe) sauf si le sujet et le verbe sont ensuite inversé (si le sujet n’est pas exprimé, on met une virgule)
- on veille autant que possible à ne pas fausser le décompte du vers en introduisant une virgule après un e caduc élidé (pas de virgule dans « Que X au coup donner… » pour ne pas suggérer que « que » et « au » font 2 syllabes)
- on peut mettre des virgules autour d’une proposition subordonnée relative, sauf si elle est déterminative (= si elle est indispensable pour comprendre l’antécédent)
- les points-virgules sont utilisés pour juxtaposer les propositions longues ou qui comprennent des virgules
Concernant les tirets et parenthèses :
- pas de tirets (les incises sont placées entre virgules)
- pas de parenthèses (même quand il y en a dans le manuscrit de base, car elles ont une toute autre fonction)
Les deux points sont utilisés :
- avant une énumération
- avant des propos au discours direct
- avant une forme de présentatif (exemple : II, 17, titre)
- en de rares cas, avant certaines constructions non verbales (exemple : II, prol., v. 92)
- pas d’autres cas, y compris quand une proposition ressemble à une explication
Concernant les points d’interrogation et d’exclamation :
- ils sont ajoutés autant que possible, pour faire vivre les discours directs et donner à entendre les commentaires de Cretin quand il s’émeut de ce qu’il raconte ou quand il plaisante
- on ajoute un point d’exclamation après « o » quand c’est l’interjection « oh » (mais pas « ô », suivi d’un nom de personne)
Collations
Les collations ont été réalisées avec les autres manuscrits de la Chronique. Elles sont associées à la version semi-modernisée du texte.
Tout changement de mots, inversion de termes ou de vers, ajout ou suppression est indiqué. Les suppressions sont indiquées par l'abréviation "om." (omission).
Les collations ne reproduisent pas les variantes orthographiques (sauf lorsque celles-ci engagent le décompte des syllabes : par exemple "esprit" et "esperit"). Les mots biffés, les corrections marginales ou interlinéaires ne sont pas indiqués. Quand les mots ou vers sont des ajouts interlinéaires ou à la marge, cela n’est pas précisé.
Voir la page consacrée aux manuscrits pour de plus amples remarques sur les manuscrits collationnés.
Annotation
Les notes d’apparat, d’identification de sources et de commentaire historique ou littéraire sont en cours d'élaboration. L'orthographe des noms de personne et de lieux y est modernisée.
Les appels de notes prennent la forme d'un chiffre entouré sur lequel il faut cliquer pour ouvrir une fenêtre ; il est également possible d'afficher toutes les notes dans un onglet dédié.
Glossaire
Les mots présents dans le glossaire ne sont pas signalés dans le texte édité afin de ne pas l'alourdir. Ils sont réunis dans une page glossaire et peuvent être affichés dans un onglet dédié.
Les termes figurant dans les collations ne sont pas ajoutés au glossaire, car cela reviendrait souvent à donner un sens à ce qui est une erreur manifeste d'un copiste (qui fait une faute d'écriture ou s'est trompé dans les lignes qu'il copie). Cependant, lorsqu'un témoin offre une variante significative, les termes sont ajoutés au glossaire, si besoin.
Index
Les noms propres de personnes ou personnages sont répertoriés dans un index, accessible depuis le menu général.
Dans le texte édité et les descriptions des miniatures, les noms indexés sont surlignés en gris. Au survol, une bulle permet de fournir des informations minimales : elles sont extraites de wikidata et contrôlées par les éditeurs.
Les différents rois sont par ailleurs représentés, dans l'onglet "Annexes" du menu général, sous forme généalogique et chronologique afin de figurer leurs liens, la durée et l'étendue de leur règne.
Un index des noms de lieux est en cours de construction.